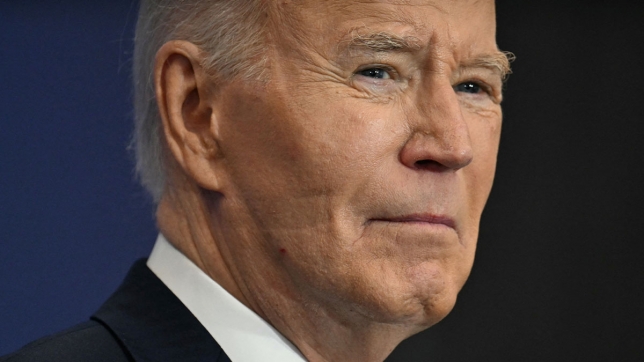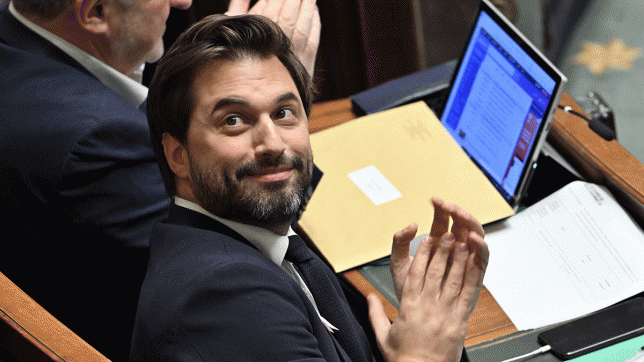Partager:
Le 3 octobre 1980, une puissante bombe explose près de la synagogue de la rue Copernic, faisant quatre morts. Au procès de cet attentat, l'un des premiers policiers arrivés sur les lieux a rassemblé mardi, 43 ans après, ses souvenirs d'une "scène de guerre".
Costume sombre, tempes grisonnantes, le commissaire divisionnaire à la retraite André Cerf s'avance à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris, qui juge en son absence l'unique accusé de cette attaque meurtrière, le Libano-Canadien Hassan Diab.
Sans s'aider d'aucune note, le témoin de 77 ans replonge dans ce vendredi d'octobre 1980, quand "vers 18H40-18H45" il est appelé avec ses collègues du commissariat du XVIe arrondissement de Paris rue Copernic, où une explosion vient de se produire.
Il se souvient encore "des volutes de fumée, des flammes" et à mesure qu'il s'approche "du sinistre", des "dégâts" de plus en plus considérables et des corps "déshabillés" ou "pulvérisés" de trois victimes - une quatrième décèdera à l'hôpital deux jours plus tard.
Un périmètre est établi pour éloigner les "curieux" et faire les premières constatations.
Les mains appuyées à la barre, l'ancien enquêteur suit des yeux les clichés en noir et blanc qui défilent à l'écran, et montrent des voitures retournées ou carbonisées, les vitrines des commerces et les fenêtres d'immeubles soufflées par l'explosion... "Une scène de guerre", résume André Cerf.
Absentes du dossier de police, des photos de blessés sont exhumées des journaux de l'époque. L'une d'elles, parue dans Paris-Match, dévoile le visage d'une femme transformé en "masque de sang", au côté d'un jeune enfant les yeux ahuris.
- "Coiffure à la Stone" -
De "concert" avec la brigade criminelle, André Cerf s'attèle à une autre tâche: "trouver le point d'attaque" de l'explosion et prélever les indices, à une époque où n'existaient ni ADN, ni caméras de vidéosurveillance, ni téléphones portables géolocalisables, souligne-t-il.
Sur place, les policiers trouvent un "cratère" sur la chaussée et à environ 1,50 m, au milieu des décombres, les "restes d'une motocyclette", décrit encore le témoin.
C'est grâce au numéro de série "encore visible" de cette moto, dont il n'est resté pratiquement que la fourche après l'explosion de dix kilos de pentrite posés sur sa partie arrière, que l'enquête peut "commencer", salue l'ancien commissaire André Cerf.
Le numéro "complet" permet de remonter jusqu'à un concessionnaire et à un acheteur, qui a payé la moto en dollars et présenté un passeport chypriote, retrace à son tour un ancien commissaire de la brigade criminelle de Paris, entendu pendant plus de quatre heures.
Mémoire aussi vive que son prédécesseur à la barre, Jacques Poinas, 71 ans, se remémore un détail "frappant". Un témoin avait décrit la "coiffure à la Stone" (du nom de la chanteuse qui formait un duo avec Charden) de l'acquéreur, telle qu'elle apparaît sur l'un des portraits-robots du suspect.
Le président de la cour, Christophe Petiteau, confronte ces portraits-robots aux photographies de Hassan Diab dans les années 1980. Sur l'une, la chevelure du Libano-Canadien est "un peu différente, plus gonflante". Sur l'autre, l'ex-commissaire retrouve "plus les cheveux lisses" de Stone.
Le nom de Hassan Diab n'apparaîtra dans le dossier de la rue Copernic qu'en 1999, à la faveur de renseignements sur la saisie à Rome en 1981 de son passeport dans les effets d'un membre présumé du FPLP-OS, groupe dissident du Front populaire de libération de la Palestine auquel l'attentat est attribué.
"Cela a tout changé", assure Jacques Poinas, qui avait laissé des années plus tôt en quittant la brigade criminelle une enquête qui n'avançait guère, bien que déjà "orientée" sur la piste palestinienne par quelques "éléments matériels" et les "bribes" de renseignements de services étrangers.
Qu'il ait fallu 18 ans pour que l'information sur le passeport, devenue la pièce centrale de l'accusation, parvienne jusqu'à Paris semble laisser encore pantois le commissaire Poinas. "L'enquête aurait été tout autre", soupire-t-il.
Hassan Diab clame depuis le début son innocence, affirmant qu'il passait des examens à l'université de Beyrouth au moment de l'attentat et qu'il avait perdu son passeport.
Incarcéré en France en 2014 après une longue procédure d'extradition, le professeur de sociologie d'Ottawa avait bénéficié d'un non-lieu en janvier 2018 et était reparti libre au Canada. Son renvoi devant les assises avait été ordonné trois ans plus tard.
Verdict attendu le 21 avril.