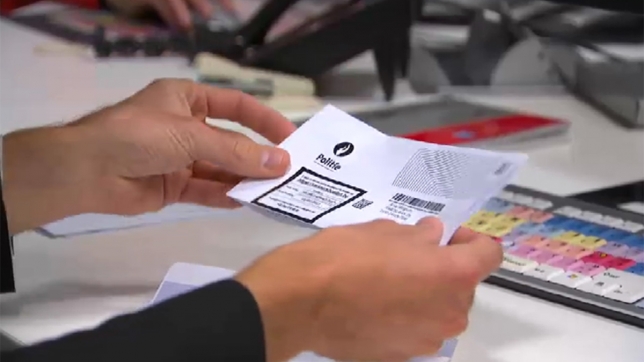Partager:
Des cadavres nus, alignés dans la boue d'un cimetière de Timisoara : la ville où a débuté en décembre 1989 la révolution roumaine reste associée à la duperie du "faux charnier", archétype de l'emballement médiatique, trente ans avant l'ère des fake news.
A la veille de Noël, alors que le dictateur Nicolae Ceausescu est arrêté après une semaine de manifestations, le public occidental découvre avec horreur des corps, certains mutilés, attribués aux exactions de la Securitate (police politique roumaine).
Les images tournent en boucle sur les chaînes de télévision et à la Une de la presse étrangère, dont les envoyés spéciaux sont arrivés par dizaines dans le pays jusqu'alors fermé au monde par le régime.
C'est dans le cimetière des indigents de Timisoara qu'ils ont découvert ces dépouilles alignées au sol, présentées comme la preuve de la répression sanglante du soulèvement.
La révolution roumaine a fait un millier de morts dans le pays, dont une centaine à Timisoara. Mais à la fin de l'année 1989, le chiffre de 4.630 victimes pour la seule ville de Timisoara est repris par la presse internationale qui évoque aussi l'existence de multiples charniers.
Il faudra attendre le mois de janvier pour que le bilan se précise et que la supercherie du cimetière soit mise au jour : les cadavres étaient ceux de personnes mortes avant les événements, puis sortis de terre.
- "Robinet à images" -
S'agissait-il d'une mise en scène destinée à accabler le régime de Ceausescu ou d'exhumations menées par des Roumains à la recherche de leurs disparus ?
Procureur à Timisoara en décembre 1989, Romeo Balan croit au second scénario. Dès le 22 décembre, des magistrats et des légistes roumains ont examiné les cadavres du cimetière et constaté que la mort était bien antérieure au soulèvement, explique M. Balan à l'AFP.
"Mais rien n'y a fait, les gens ont continué à creuser dans d'autres endroits", se souvient-t-il.
"Ils ne savaient pas où étaient leurs morts, ils cherchaient partout, dans des endroits où il aurait pu y avoir des fosses communes", raconte aussi à l'AFP Ioan Banciu, un habitant de Timisoara.
Son épouse Leontina avait été abattue lors d'une manifestation à Timisoara le 17 décembre. Elle était morte dans ses bras sur le trajet de l'hôpital. Quand il y est retourné, le corps avait disparu.
Cet entraîneur de football a découvert deux semaines plus tard qu'une quarantaine de morts, dont son épouse, avaient été sortis de la morgue, et incinérés à Bucarest, le régime espérant effacer les traces du massacre. Une histoire vraie, celle-ci.
- Imaginaire "sanguinaire" -
Dans l'atmosphère de confusion et de psychose qui régnait, les reporters "ont pris le train des rumeurs en marche", observe le journaliste Michel Castex, qui a couvert la révolution roumaine pour l'AFP, à Bucarest.
Le 24 décembre 1989, l'une des dépêches de l'AFP écrite à Timisoara décrivait les "atrocités" du "charnier". Les interlocuteurs roumains attribuaient ces morts aux "fanatiques de la Securitate", parlant de "mutilations insensées".
"La révolution roumaine, c'était aussi un imaginaire collectif, un décor, on attendait ces images puisque Ceausescu était un dictateur sanguinaire", analyse l'historien des médias Christian Delporte.
"Quand on veut croire à quelque chose, on se trouve toutes les raisons d'y croire et le caractère ubuesque de cette famille Ceausescu ajoutait à l'idée que tout était possible", observe aussi Michel Castex.
Dès le 29 décembre, les journalistes de l'AFP écrivaient que le bilan de 70.000 morts dans toute la Roumanie était probablement très surévalué, insistant sur le climat d'incertitude extrême. L'imposture du charnier ne sera établie que fin janvier.
Recherche du scoop, du spectaculaire, pression de la concurrence ont aussi joué un rôle dans ce que l'association Reporters sans frontière a qualifié "d'une des plus grandes duperies de l'histoire médiatique moderne". Elle a durablement porté atteinte à la crédibilité des médias.
"C'était la première fois qu'on avait des images en direct d'une révolution en Europe de l'Est et l'image était considérée comme une preuve", malgré l'absence de contexte, relève Christian Delporte.
"Aujourd'hui, poursuit l'analyste, on se méfie beaucoup plus du robinet à images. A l'ère des réseaux sociaux, on peut imaginer qu'il y aurait eu très vite du +fact-checking+".