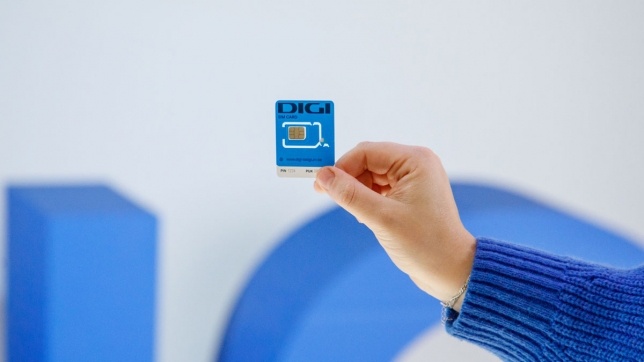Partager:
"Je n'avais jamais vu des femmes conduire avec une telle attitude, une telle indépendance!". La première fois qu'il est arrivé à Ouagadougou, le cinéaste nigérian Kagho Idhebor a été impressionné par le nombre de femmes à moto, véritable symbole de leur émancipation.
Dans la capitale burkinabè, "il y a plus de motos que de voitures, et plus de femmes que d'hommes sur ces motos", sourit le réalisateur qui a décidé de faire un film sur le sujet.
Dans son documentaire "Burkina Babes" en compétition au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), qui s'est achevé samedi, le réalisateur commente, fasciné, chaque caractéristique des Ouagalaises à moto qu'il a photographiées.
Habillées en jean ou en tailleur, portant parfois un enfant sur leur dos, ces femmes de tous âges déferlent dans les rues de la capitale.
"La moto est d'abord une nécessité" pour se déplacer, explique une habitante de Ouagadougou, Valérie Dambré, le temps d'un arrêt au feu rouge sur ses deux roues.
Mais ce moyen de transport fait intégralement partie de la culture burkinabè.
"Nous avons utilisé la moto avant d'utiliser la voiture, contrairement aux pays côtiers où les gens optent plutôt pour la voiture et la marche", explique l'anthropologue burkinabè Jocelyne Vokouma.
- Autonomie financière -
Et la moto est devenue il y a déjà plusieurs décennies un symbole de l'autonomie financière pour de nombreuses femmes.
"Jusque dans les années 1980, une femme était fière de dire que sa moto était achetée par son mari. On disait : +Mon mari est capable+", se souvient l'universitaire.
Mais, poursuit-elle, après des réformes économiques d'austérité et des réductions de dépenses publiques mises en place en 1991, "beaucoup d'hommes se sont retrouvés sans emploi".
Alors, "les femmes ont commencé à travailler dans la vente de fruits et légumes en périphérie de Ouagadougou, sont passées du vélo à la moto" et ont acheté leur propre véhicule, raconte-t-elle.
Selon Mme Vokouma, l'ancien président du Burkina (1983-1987) et icône révolutionnaire Thomas Sankara a également eu un "rôle émancipateur et a déconstruit un état d'esprit traditionnel pour pousser les femmes dans l'espace public, hors de leurs foyers".
"Les jeunes femmes d'aujourd'hui ont baigné dans ses idées", résume t-elle.
Bérénice Zagali n'en pense pas moins. Etudiante à Ouagadougou, elle est formée à la mécanique dans l'unique centre du pays exclusivement féminin qui enseigne des métiers habituellement réservés aux hommes.
"Des hommes cherchent à te décourager, te disent +Toi femme, pourquoi tu viens faire ça ici ? C'est le métier des hommes. Ta place est dans la cuisine, dans le bureau+", affirme-t-elle avec colère.
- "Mieux que ça" -
"Moi je peux faire mieux que ça", assure la jeune femme dans sa salle de classe, un hangar rempli d'outils et de pièces de voiture.
"Il y a des proches qui nous envient", abonde une de ses camarades, Salamata Congo, dans le bruit des scies et des marteaux.
Comme elles, plus de 700 Ouagalaises se sont formées depuis 1997 au Centre féminin d'initiation et d'apprentissage aux métiers (CFIAM).
"On forme des filles en carrosserie, en mécanique automobile et en maintenance industrielle", indique le directeur du centre, Bernard Zongo.
M. Zongo a créé ce centre car il souhaitait amener "les filles" vers des "métiers non traditionnels, de façon à leur assurer aussi une bonne autonomisation économique".
Pour assurer le confort des jeunes femmes, le directeur du CFIAM a embauché une psychologue à temps plein et a aussi ouvert une crèche qui accueille les enfants des étudiantes.
Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest comme le Niger, la Côte d'Ivoire et le Mali ont visité le CFIAM pour importer l'idée de M. Zongo. Mais "là-bas, ça n'a pas pris", regrette t-il.
"Le projet demande de déconstruire l'idée que des métiers sont réservés aux femmes et d'autres aux hommes. La société burkinabè était déjà préparée à cela", explique Jocelyne Vokouma.
Prochaine étape du CFIAM: obtenir l'autonomie financière.
Aujourd'hui, 75% des ressources des centres viennent d'ONG et les fonds restants sont les contributions des familles des élèves, pour payer la formation de deux ans qui coûte 100.000 francs (152 euros).
Symbole de la réussite de son projet: "même les garçons réclament leur place" sourit le directeur, Bernard Zongo.