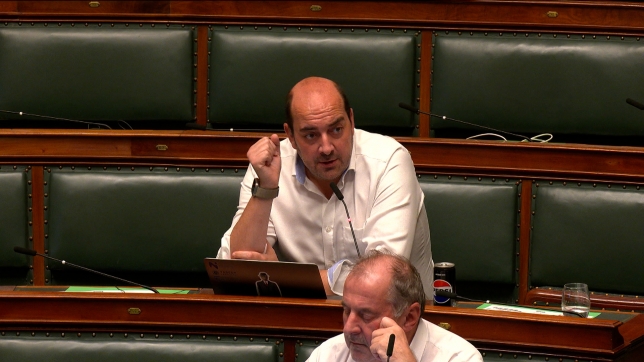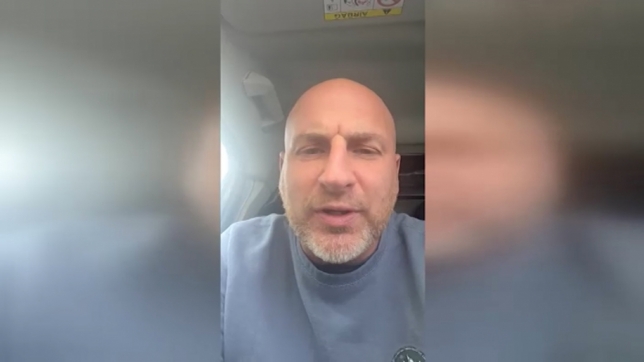Partager:
En trente ans, plus de 75 % des terres émergées se sont asséchées, selon un rapport de l’ONU. En parallèle, 2024 s’annonce comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant pour la première fois le seuil symbolique de 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.
Un rapport de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), présenté à la COP16 à Riyad, révèle une aridification dramatique des sols.
Entre 1990 et 2020, 77,6 % des terres ont enregistré des conditions plus sèches par rapport aux 30 années précédentes.
Les zones arides ont progressé de 4,3 millions de km², soit une superficie supérieure à celle de l’Inde, et couvrent désormais 40,6 % des terres émergées, excluant l’Antarctique. Les régions les plus touchées incluent le bassin méditerranéen, le sud de l’Afrique, l’Australie, ainsi que des parties de l’Asie, de l’Amérique latine et des États-Unis.
Cette tendance menace directement 2,3 milliards de personnes vivant dans ces zones. Les conséquences se font déjà sentir sur la sécurité alimentaire mondiale, avec des rendements agricoles en chute, une intensification des conflits pour l’eau et des déplacements de population.
L’aridification est une transformation permanente et irréversible
"Contrairement aux sécheresses temporaires, l’aridification est une transformation permanente et irréversible", souligne Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de l’UNCCD.
Si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, 3 % supplémentaires des zones humides deviendront arides d’ici à 2100.
2024 : une année record pour la chaleur
Le réchauffement climatique continue de battre des records inquiétants. Selon le Service changement climatique Copernicus, 2024 sera l’année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant de plus de 1,5 °C la température préindustrielle.
Ce seuil, fixé comme limite ambitieuse par l’accord de Paris, marque une alerte pour la communauté internationale.
Le mois de novembre 2023 a été 1,62 °C plus chaud que la moyenne des mois de novembre d’avant l’industrialisation. Sur les 17 derniers mois, 16 ont enregistré une anomalie dépassant 1,5 °C.
Des impacts catastrophiques
Le dépassement durable de ce seuil pourrait aggraver des phénomènes extrêmes déjà en augmentationn comme :
- Les sécheresses en Afrique australe et en Amazonie
- Les typhons dévastateurs en Asie
- La fonte accélérée de la banquise antarctique
- Les catastrophes naturelles (qui, en 2024 ont causé des pertes économiques estimées à 310 milliards de dollars, selon Swiss Re, un assureur mondial)
Comment l'expliquer?
L’effet combiné du réchauffement climatique et du phénomène naturel El Niño explique en partie ces records. En 2024, la dissipation de chaleur initiée par El Niño reste particulièrement lente.
Une étude publiée dans Science avance que la réduction des nuages de basse altitude et la fonte des glaces ont diminué la capacité de la Terre à renvoyer l’énergie solaire dans l’espace.
Une réponse internationale insuffisante
Malgré l’urgence, les politiques climatiques actuelles restent insuffisantes.
Selon l’ONU, elles mèneraient à un réchauffement de 2,6 à 3,1 °C d’ici la fin du siècle. La COP28 à Dubaï a approuvé une transition énergétique, mais sans engagement explicite pour une sortie rapide des énergies fossiles.
Les pays en développement, qui réclament une aide annuelle de 600 milliards de dollars, devront se contenter de 300 milliards promis par les nations riches d’ici 2035, un financement jugé largement insuffisant.