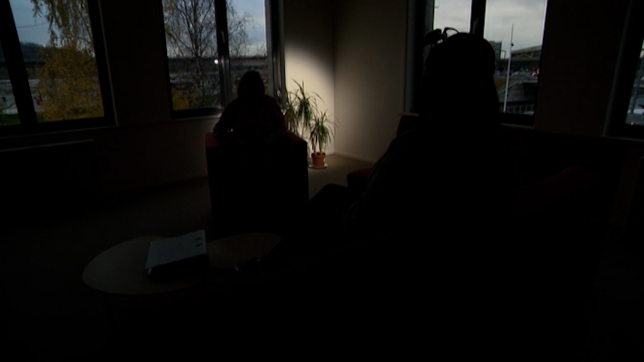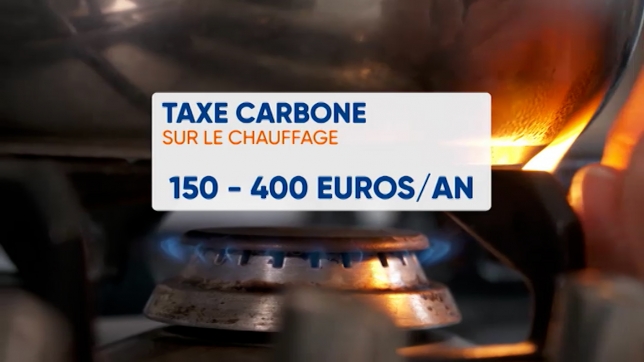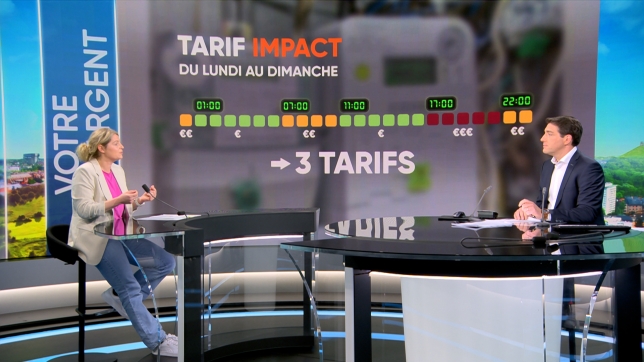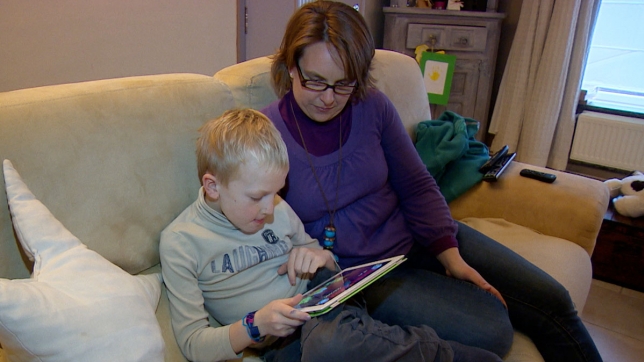Partager:
Alors que Volodymyr Zelensky accepte une trêve de 30 jours, la Russie ne se presse pas pour entériner un accord. Moscou pose des conditions strictes et affiche sa méfiance face à un éventuel dialogue avec Washington.
L'annonce d'une trêve potentielle entre l’Ukraine et la Russie suscite autant d’espoirs que d’incertitudes. Si Volodymyr Zelensky a donné son accord pour un cessez-le-feu de 30 jours, Vladimir Poutine reste méfiant. À Washington, on estime que "la balle est dans le camp de Poutine", mais rien ne garantit qu’il acceptera de jouer le jeu.
Le président russe aurait en effet perçu l’accord conclu mardi en Arabie Saoudite comme un coup monté dans son dos. Par ailleurs, la reprise de l’aide militaire américaine à l’Ukraine, notamment en matière de renseignement satellitaire, ne l’incite pas à la modération.
En guise de réponse, Vladimir Poutine s’est rendu dans la région de Koursk, une première depuis l’incursion des forces ukrainiennes en août dernier. Une visite hautement symbolique alors que l’armée russe y mène actuellement une contre-offensive intense.
L'Ukraine en difficulté sur le terrain
Le chef d’état-major russe, Valeri Guerassimov, affirme que 85 % des territoires repris par Kiev ont été reconquis par Moscou. Face à cette pression, l’armée ukrainienne serait contrainte de battre en retraite et de se repositionner derrière sa frontière pour éviter un encerclement. Une mauvaise nouvelle pour Zelensky, qui comptait sur ces avancées militaires pour peser dans les futures négociations de paix.
Sur le plan diplomatique, la Russie maintient ses exigences : elle refuse de céder les territoires conquis dans l'Est en 2022, réclame la démilitarisation de l’Ukraine et exige un engagement formel que Kiev ne rejoindra jamais l’OTAN.
De plus, Moscou exclut toute présence de troupes d’interposition européennes si elles sont affiliées à l’Alliance atlantique
Un espoir fragile
Donald Trump, de son côté, a annoncé l’envoi de négociateurs à Moscou. Pourtant, le Kremlin n’a pas confirmé cette information, se contentant d’indiquer qu’il attendait "des précisions complètes" de la part des États-Unis.
Une seule avancée concrète semble envisageable : une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump pourrait avoir lieu sous peu.
Mais cela ne signifie pas pour autant un rapprochement. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, les positions de Moscou et Washington ne seraient compatibles qu’à "50 %".
De plus, les Russes craignent qu’une trêve temporaire ne permette à l’Ukraine de se réarmer et de se renforcer, alors que l’armée russe a l’avantage sur le terrain.
L’Europe spectatrice
Face à cette nouvelle dynamique, l’Europe semble reléguée au second plan. Volodymyr Zelensky, malgré des concessions économiques aux États-Unis, a consolidé ses alliances avec Washington.
Un retour à une logique de guerre froide, où le bras de fer se joue avant tout entre Moscou et les États-Unis, semble se dessiner.
Les Européens, eux, restent de simples observateurs, sans véritable marge de manœuvre dans cette crise qui les concerne pourtant directement.